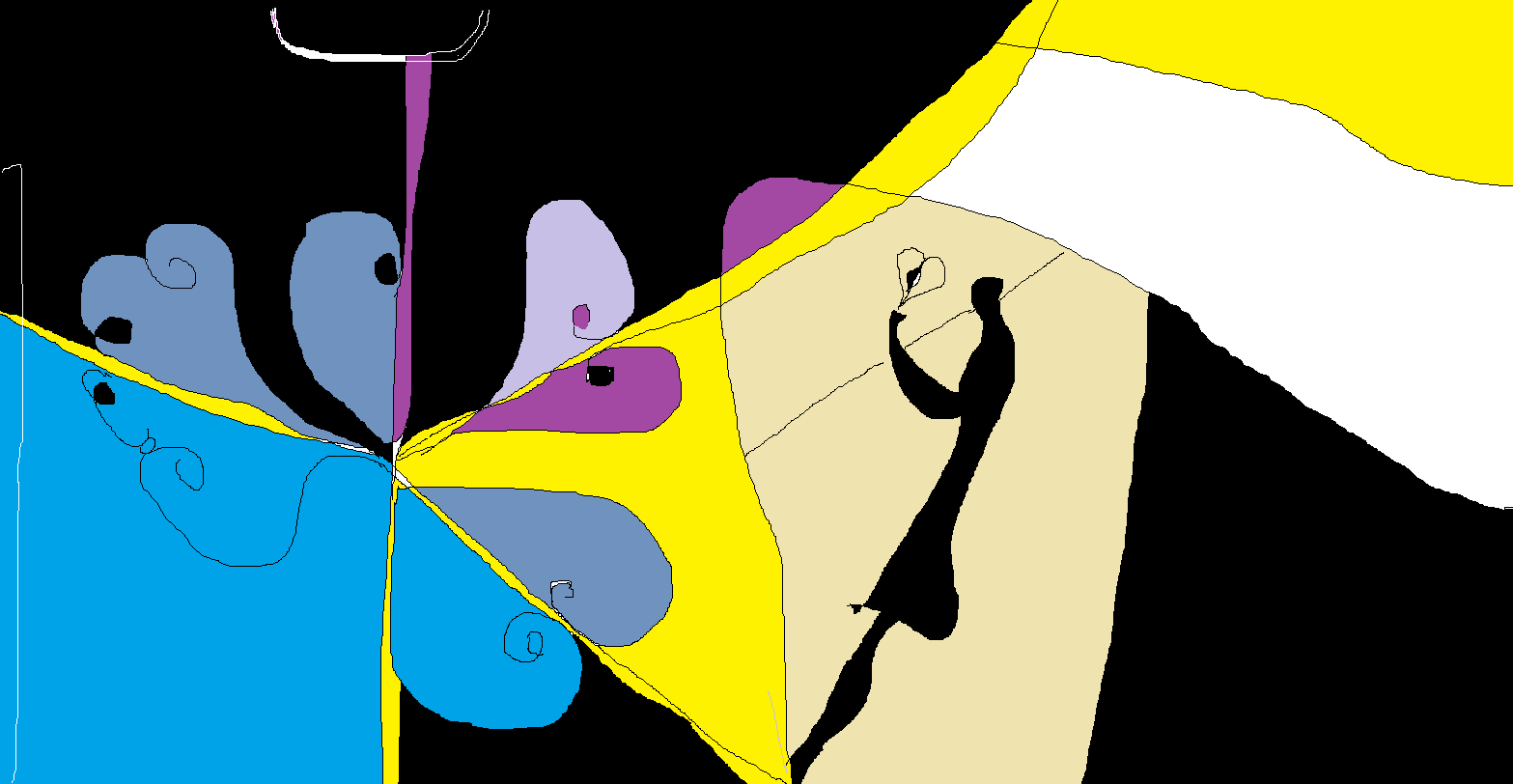juin
samedi 24 juin 2017, par
encore verte la terre
les feuilles de la nuit n’ont pas poussé.
je demeure au jardin à voir se soulever le sol
des ombres naissent toujours de la même danse montant en spirale vers le poing d’une étoile
et moi, qui suis un champ d’herbes communes, je sens soudain que vient ma transparence et qu’alors je suis à vous.
*
Nous n’y pouvons rien
L’univers bout dans notre bouche
Orgues barbares
Et plus je suis le puits et le roseau
Plus monte l’eau de la flûte
Nous n’y pouvons rien
Car nos mains sont fragiles au moindre vent
Je sens la tienne comme une barque arquée dans mon corps
La mienne dernier feuillage tombé
Ensemble parfait de l’onde en promenade
Nous n’y pouvons rien
Tu as jeté ton œil dans la mer
Et depuis l’étang frissonne
Le voyage noue les collines aux lessives des hommes
Je regarde et l’ailleurs avance à verse
*
En moi dormait un arbre
Je le pensais bois mort
Mais il songeait dans l’apnée d’un volcan
Des lampes de feu à fleurs de sein
J’ouvre les deux portes aurore et crépuscule
L’écorce d’amour dévore chaque ciel
Ce qui chante est le cœur frais des millénaires
La gouge profonde des cordes tourne
En moi l’aubier et le liège
Monte alors un sexe
Candélabre, dur, volant.
J’ai bien dit volcan
Tu sais où désormais tu sèmes
*
il y a des jours où je marche au plafond. mes racines joyeusement égrènent le ciel. ma tête lourde alors de sens rougit comme un fruit mûr. il coule de mes yeux la miellée de l’arbre. j’attends le baiser de la terre qui me chuchote" saute, viens j’ai ouvert mes flancs". mais de mon visage enceint si butiné d’ailes et de dards, s’échappe le poème parfumé de la mort.
*
Mais n’est-ce pas tu ne cesses de peigner la mer puisqu’il est sage de faire des tâches éternelles
Ne pas craindre que l’ivoire ouvre à jamais les plaies et le sel
Le sol de ta vie est des buveurs de sable
D’où que tu remontes, ta corde s’enfonce dans le vague
Et tu peignes sans fin les boucles de ta naissance
Je marque mon chemin d’une autre neige, je trace dans l’eau des très hautes altitudes
Une ligne sans écume
Le même vent nous efface
Alors nous nous aimons
Simples
*
Je me lève de l’âtre où dorment les poètes
Parmi les dépouilles de la nuit
Je secoue la cendre, je secoue jusqu’à me donner une ombre
Il y a des jours où naître corneille et d’autres, colombe
Et ce parfum du feu qui a brûlé mes ailes
Cette odeur cuite des rêves
Monte en cheminées, lente profonde
Comme des ponts savoureux
Entre la terre et l’eau
Je me lève, charbon
les doigts de suie sur ton front
*
c’est une herse qui passe
la peau de l’amour s’ouvre ainsi
et le sol sec de mon pays s’envole
graines de solitude à d’autres chemins
dans cette douleur tendre des ongles
se fendent les lignes de vie
on y pose un à un des mots
secrets
étonnés de voir qu’à chaque lieu planté
se lèvent de sagittaires
cherchant leur étoile
*
Alors la nuit dévisse dans le coeur d’une rose
Siphon de lumière
La même porte de pétales
Boit dans l’anneau des revers
A lappées de loup à lappées de chien
Comme un sexe épilé de ses épines
En bandoulière de mitraille
Rouge
Je sens le ruban nouer la tresse grise de mon épaule
Là-bas dans le dos
De l’inconnue que je deviens
Baluchon de bouches d’anges
Le mouchoir du voyageur de jour
Balance plein de mots
*
As-tu assez bu ma transparence ?
Le verre dans ta main est vide
J’ai rejoint l’ordinaire du bout des doigts
Ainsi l’ivresse de tout atteindre
Au plus profond du secret
L’entier et la fraction
Et toi aussi
J’ai regardé glisser la vitre entre nous
Comme la perle à ton front
Etais-je là
Dans le scaphandre salé de ton rêve
Ou enfuie où tu pensais d’autre chose ?
Ai-je assez retenu mon corps ?
Un pays sortait de ta bouche
Où il voulait courir
Des poignées de regrets
Me laçaient le cou
Comme la fumée d’un cigare
Attache les soupirs
Aux lampes de la maison
*
des semelles de poussière et de temps
terrassent mon lit à coups de pierres
enterrant mes enfants comme des graines vides
sous le crachat de ces cailloux
je n’ai pas conduit mon corps au bord d’une rivière
j’ai essuyé toutes les soucoupes d’or
plus une goutte
plus un sang
sur la grève lunatique des buveurs de réverbère
je suis des astres auréolés du bitume
une statue, un os, un bois de langue
une flaque de petite mort
tombée
irrémédiable du côté du désert.
*
j’ai passé la porte de ton corps
il y avait dedans une ville, blanche et les astres arrivaient à l’heure des caravanes
j’étais vêtue de ta chair d’homme
le velours pourpre de rivière
et d’agrumes
mes sandales claquaient des baisers de la pierre
j’avais un but
j’y allais je m’empressais
mais sur ma route des églises et des chambres, des citernes humaines
des fenêtres vides de ciel
les hommes par milliers avaient couvert la place
tu étais parmi eux
alors je songeai que tu étais le seul enfant et je sus te trouver.
*
Quelques fois les enfants tranchent l’air. Quelqu’un part alors recoudre le silence. Rapidement de peur d’une hémorragie. On sort sa grande aiguille en corne de marabout, son fil de pêche et son échelle. On grimpe vite dans les rideaux qui crient. On cherche les pans séparés des royaumes. Et on suture. Derrière les lèvres de l’espace, les mots se pressent, sans syllabes, la salive acide des jeunes voyelles. On tend son oreille à la couture. On devine un murmure rebelle. L’enfance sans doute à sa muselière.
*
qu’une main glisse un instant sur la joue et l’on croit que le jour vient d’interrompre la nuit
life touch
*
Peut-être es-tu étendu, ombre d’un arbre d’autres forêts, à dormir dans ce monde. Et le gris fleuve qui s’échappe de tes cheveux abrite le frais. Peut-être attends-tu à la porte des fontaines, que s’en viennent des ailleurs. Peut-être finis-tu chaque jour un rêve, le choix des lumières ou celui de la nuit, les deux pour disparaitre. Peut-être gardes-tu dans le drap sombre du bois, l’aveu d’amour qui lèverait le mystère.
Peut-être cours-tu dans les veines enfouies de mon souffle. Je tiens l’éventail et l’écorce.
*
il y a ce soupirail de lumières contre ma vitre
ma main cherche la monnaie tombée de ton coeur
une pièce mûre entre les barreaux
et mes doigts s’agitent en vain, prisonniers du miroir
j’effile ma paume, poème après poème.
Et bientôt feuille morte elle tombera sur son trésor
mon arbre nu d’hiver.
*
Comme il est bon de se serrer contre soi
...de se retirer le front touchant le cœur
et l’esprit bat, du rythme du non-dit
Bon de couver sa nichée d’œufs saillis de la douleur.
Mais mon oreille murmure alors des mensonges, l’enfance et les corneilles.
Bon de retrousser son corps du côté de l’âme, de frayer son chemin dans le labyrinthe
Un lac m’attend
Son regard sans paupière m’aime pour toujours
Il n’y a rien du côté des poètes, ce sont des êtres raidis dans les orgues du monde
L’homme n’existe pas, c’est l’opium du Chant
Irrespirable
*
Ce ne sont que des fils de fer qui me gardent de falaise
Des rubans sortis des forges.
Il y en a devant moi et puis sur le sol, des soucoupes entrelacées de membranes, de poches et de fiel.
Je marche sur le cœur semé
Il craque, foisonne et se disperse. Il me rentre dans l’ombre, lame et je sens jusque sous les côtes, le baiser frais du métal
Un instant dissoute et parfaite soudure à l’imprenable
Je suis habitée, silhouette transplantée d’un organe secret
Je suis moi aimant aimer.
*
Tu me es. Je te suis. Quand j’aime, un poème me pousse à l’intérieur, une cour inconnue. Des mains l’étendue, entre des bras de ciel, le cloître du soleil.
Que tu sois là ou ailleurs, je rentre de bonne heure à la maison. Je suis la place, le bal et l’étincelle. Mon esprit à la lampe veille les ombres du plafond qui plantent leurs aiguilles dans la ronde du temps. Dormir est de la graine de fontaine.
Quand j’aime je me retire, je voudrais disparaître. Un seul mot et je serais si nue. Il faut me chercher, entre les tours, entre les rues et les pavés. Je me cache dans le jardin secret puisqu’au mystère de l’Autre. Tu me es. Je te suis. Quand j’aime, un pré de mots
*
J’aime tout, même la mort qui ancre en moi les attaches humaines, leurs corps lourds, leurs vols.
Qui me noue de brins tristes, me tresse de peur, de nostalgie ou de frivolité.
Les lentes cordes du puits, le chanvre ou la laine d’enfant.
Même la mort portière, de vie à vie.
J’aime ce qui me traverse, ce qui s’implante, ce qui me quitte.- je ne suis pas à un poème près-, ce qui embrase.
*
le ciel n’entre pas toujours par la fenêtre
il peut tomber dans la chambre
comme une langue étrangère qui coulerait de la vitre
une faille comme ça inouie
on entend ce chant, le début de l’oiseau
et soudain sortant de soi, une aile bleue
le ciel est là
*
chanson
la tempête va souffler
des arbres penchent et des maisons
des villes flanchent, des saisons
une aile sombre de maux, cris sauvages des oiseaux
notre corps va trembler
et le vent pousse la porte
et la vie douce s’emporte
je regarde étonnée :
déjà un coeur est tombé
le ciel noir s’est envolé
des vagues blanches et des moussons
des algues dansent, des grêlons
cingle un orage de faux, un déluge sans repos
d’un seul coup échappé
le vent referme ta porte
l’âme court les plaines mortes
je l’écoute affolée
dejà mon coeur est semé
puis enfin cesse l’averse
comme un dimanche, la floraison
comme une branche, l’oraison
une plume à mon chapeau, un chant paisible à nouveau
battant le coeur en liesse
si un fétu d’amour perdu
tant et si loin a disparu
le ciel tourne dans le cadran
le soleil brille maintenant
*
Je sarcle la terre, cette peau d’humaine sèche. J’y enfonce mes dents et je mords la poussière. Je sens à chaque veine les racines, les bulbes et les cals. La semence a soif.
Le jardin est immense, le bout du monde à sa barrière. C’est le continent de la lumière et j’y travaille comme une ombre.
Quand l’eau se lève à l’Est, prête au voyage. Quand le fleuve monte là-haut comme un songe qui s’évente, le pays attend. Il ouvre ses citernes, découvre ses calices. J’entends, son corps se déplie pour la pluie. Et chacun de mes gestes prépare ton averse.
*
Il faut en finir avec le sol. Trancher au rasoir les racines. Père, ton arbre est lourd.
Monter, j’ai des doigts crocheteurs de murs, des rongeurs de palissade. Il faut en finir.
J’étais allongée dans le pré et le voile de peau percé de graines. Je mutais champ, j’étais prête. Chaque molécule germée et juste quelques tiges cousues de mon âme à ma tombe.
Il faut en finir avec ce lit vif. Quand tout pousse et traverse pour devenir le corps des fleurs. Avec le sol.
Droite drosser sa voile dans le bleu, l’informe bleu et ses tripots de fumée. Et moins mon pied dans la glèbe, plus la transparence sans pays.
Leviter peut-être comme un bubble gum, ventriloque du poème.
*
J’ai mis un cri à la bouche du fleuve.
Oh ! Pas bien grand mais cette épingle qu’il charrie de pierre en pierre.
Je l’ai mis là pour qu’il court sa vie de cri, la mousse.
Je regarde couler pour toujours ce nom.
Il fait sur le ciel qu’il longe, une éraflure à peine, mais j’entends plus loin, le léger soubresaut d’un pont qui se retire
Quand mon aiguille griffe ses jambes, laissant là son écume, d’un seul cri, d’un seul.
*
C’est le livre des choses qu’on lit quand on est seul
-les paroles humaines vous charrient au boucan
Certains bruits arrivent du désert
Ils conduisent le vent
D’autres brossent le volcan
Certains pécorent, fricotent,,bégueulent
Mais le vin, la table et la pierre
Pénètrent la solitude jusqu’au mot
Engloutissent l’esprit au noyau du voyage.
Et le mien si muet qu’il faut le voir froisser ma gorge
Plante sa langue dans un poème
*
heureusement le ciel est bleu, sinon nous n’aurions jamais eu envie de lever la tête
et les dieux auraient manqué de naître
je parle des dieux mais sont-ils autre chose que ce manque de mot
j’ai besoin de secret
j’ai besoin d’un champ d’énigmes, mes mains dedans, battant campagne
et que l’on semble fertile ou maigre
chaque tige hisse le goût de vivre
mais le plus mystérieux
le plus occulte
est ce qui me nomme, puis me dilue
là-haut,
d’une ecchymose jusqu’à la mer enfin
*
de grands fruits de verre
pendent aux yeux des femmes
l’amour est une carrière de feu et de sable
on y jette parfois ses amandes
qui crépitent, pauvres noyaux
laissant le parfum et l’huile
dissoudre la chambre et la pupille
elles penchent du côté des images
une vue sur le ciel, une autre sur la mer
une pleine louche d’ambre et d’esquilles
des mouches y volent comme des flammes
C’est une ville sans enfants
Ici ne se promènent que des âmes chauves
Il ne sort des bouches que des flots d’ancêtres hurleurs
Des boîteux et des noyés
Un vent pourtant peigne les drapeaux
Ça ne se discute pas
Ce qu’ils se racontent lui et eux ne m’appartient pas
Je cherche parmi les humiliés
L’homme planète
Le porteur de gazelles
Son chant cosmique
Façonne mes boucles
Je ne peux dire qu’il m’aime
Mais son doigt de maître nageur
Apprête les fils de l’eau
*
nous nous sommes quittés tu regardais par la fenêtre
ton ombre courait déjà sur le trottoir
ce qui restait ici chiffonait le journal
avec des doigts distraits
et de prendre l’air de rien ne me permit pas de la rattraper
je dégainai mon mouchoir quatre couches de ma poche revolver
pourchasser le cafard
aucune menace n’essuya la déroute
tu étais loin, sur ton cheval mirage.
*
je ne connais pas la mer, ce n’est pas le bruit familier, ni l’odeur. alors il faut l’inventer. le nécessaire lointain.
en moi, ce pouls qui tape à la berge. en moi, ce glissement du sable, le coquillage et de fertiles coraux. et tout autour un vent de sel et de couteau pour sculpter mes cheveux.
la mer va à l’essentiel, c’est-à-dire à la courbe invisible de la Terre, là où l’on craint de tomber comme des pierres de falaise.
dont on nous dit que c’est une illusion.
mais nous sommes des enfants. la ligne qui dessine l’invisible fait le mur et la peur. dans le pays entier se dressent des palissades, des gardes-fous.
Et la montagne qui grimpe sur nos chaises pour changer le soleil cache la mer sous ses jupes.
*
Les a-t-on choisis ? Ils sortent d’une citerne d’eau de pluie.
Les mots comme des bulles alors que l’on ne peut garder.