mai
dimanche 21 mai 2017, par
J’ouvre mon pays il a deux bras. Une plaine sort de mon arbre et des séismes comme des labours à semis. Un homme dort en chemin. J’ouvre encore et le ciel me déchire, l’eau bien sûr et ses croupis. De mon torse, s’échappent des éboulis du vent, le torrent mort de mes jours. Les continents s’enfuient, le sol fond. J’ouvre toujours et des frères naissent, des foules, des débris. Parfois entre mes cuisses frétille un enfant, comme un rubis de sang. J’ouvre et me disloque la vie. C’est une fraction qui roule vers l’infini. Et quand le monde est libéré vieux chien pisseux, je prends la laisse et je me sors.
*
C’est un jour qui ne saura pas qu’il est apparu et qu’il s’en va : tout est resté pluie et robe de chambre. Je guette le dos du ciel. Lent encore le deuil monte, d’une vie de nuages.Une lisière où court un cousin nègre de Sibérie, car la nuit arrive par la même porte que le jour.
Far West siphonnant la lumière mon azur tombe au fond d’un lac. Chaque fois. L’éternité ne l’a pas encore rempli. Quand j’étais lacustre vêtue de roseaux je le savais mieux : l’eau est la lumière des choses qui s’en meurent.
Demain de graines improbables, dans la main je tiens un exojardin et je serre. Toutes planètes sèches à devenir.
*
Je te parle de ciel mais tu sais comme moi qu’il ne vient pas tous les jours. Parfois la poussière monte en doublure et l’on sent bien que l’on respire lourd. Un cyclone de glèbe tout autour, on colle à sa semelle. On ne réfléchit plus au miroir du temps
Notre corps tâte son costume d’humus, notre esprit la perte du labyrinthe et le cœur des inclusions d’ambre dur. Le ciel patiente à la poste du vent
Mon ami c’est long que je t’attends
On se dit interminable cage, on se pense à la renverse, le pied terrien pour toujours
Quand un bleuet nous pousse entre les jambes.
*
Chemin des pierres, je marche et elles crissent, comme une plainte aiguë longtemps prisonnière.
Papier à bulles. Le jour s’écrit dans ces phylactères. Tu le vois ? Tu l’entends ? Je marche et la route ouvre des maisons dans lesquelles dorment de vieux mots. Je marche et chaque pierre chaque touche.
J’écoute la plainte. Les pierres comme moi sont cousues de soupirs qui ne parlent qu’au pas du simple voyageur.
Je n’écris plus. J’écoute. Et chaque bruit me déchire. Ma chambre me sort par les semelles.
*
Parfois un homme bleu dort sur ma tête. Sa chemise flotte car il rêve loin. Nous roulons ainsi comme une neige d’un bord à l’autre de la nuit à la vapeur d’amour. Quelque chose qu’on sait, léger et transparent mais il n’y a que l’hiver et les hauts froids qui peuvent le dire. Alors on se demande pourquoi il n’existe pas des nuages d’infini noirs et profonds qui viennent et montent quand pour moi il se dévêt.
*
C’est l’heure de la pesée du ciel. 200Gr de moineau pour des tonnes d’averses. Je m’y prends ainsi : dans le noir de mon œil, je mets le leurre d’un rêve. Le ciel appâté entre sous les paupières. Je referme aussitôt, je serre le lacet. Ça me fait deux valises pesantes. Le reste est affaire de soustractions. Parfois par malice, je ne me déduis pas. Je feinte le nuage. J’appelle ça un jour d’humain, c’est-à-dire de Terre à terre, de ce corps de sable à ce jardin immense.
200gr de moineau s’échappe quand même...
*
Il y a des matins où la chambre à poèmes reste close. On vient comme un enfant à la porte écouter bruire l’amour sans lui.
J’essaie quelques mots comme des sésames entre les griffes du Sphinx. Ils ne s’ouvrent pas ;
amour sexe et mandoline. Rien, que le ciel des écailles.
L’amour est occupé pour l’instant, veuillez déclamer à votre tour
J’ai la bouche pleine, une seillée,
pour la prochaine averse le recueil de l’Inattendu
*
je veux te parler, lointain, dans ma gorge l’oeuf de l’oiseau qui t’est destiné
je veux te parler et j’en suis encore à construire le nid
je rassemble les brindilles du chant et j’ai tant de mal
j’hésite entre rester de la nuit ma compagne de silences
et ouvrir l’aube aux lèvres roses
ma mère est morte dans l’aurore, dissoute dans la lumière
toute la nuit je chantai pour elle la berceuse
ne t’étonne pas alors que je ne sache mon camp
la mort qui chante ou la vie qui se tait
*
Tu sais mieux que moi que la mer se couche
Une femme comme une autre
Car les hommes sont bleus courbés sur elle
Pénétrant toute sa transparence
Alors on voit que montent des seins blancs parmi l’écume
Comme le vent enfin lui glisse sous la peau.
Et l’ébranle et la secoue,
Puisque chaque fille exhale infiniment, ondes creusées
Plus loin
Parce qu’un ciel l’a baisée
Poème de la nuit à son matin
de l’eau à son ciel
et du feu à la cendre
je m’ennuie . il parait que c’est nécessaire. alors tu comprends le temps et le précieux
*
je suis comme l’enfant qui dort le poing fermé dedans le monde attend patiemment que l’oiseau pépie.il s’ouvrira des gouttes par poignées et du sang aussi puisque tant meurent à l’heure de naître.
j’aimerais parfois qu’une île y ait dormi, une ancre dans les territoires de l’eau, que la main de toi y soit prise, un arbre comme tu le sais
le poing fermé le plus longtemps possible rebelle car dedans il n’y a rien, que des choses à deviner, des lignes obscures, le futur de la caresse ou de la guerre.
*
Je dois essayer tous les coins de la maison, m’asseoir aux angles dormir aux centres enlacer les murs lire une à une les tommettes du corridor. Comme le braille du voyageur. Je dois appuyer mon rêve aux fenêtres ou les coucher dans les bains de céramique. Faire chanter mille fois les barreaux de la rampe. Trouver la note. Il y a tant d’espaces qui retiennent le secret.
*
Que manque-t-il ? Je ne sais j’ai marché vers le silence et il est là, vide creux qui me tait lui aussi
il manque à l’écriture le fil tenu-lâché par inadvertance. Il manque le lien, cet autre qui libère, l’amour seul qui crée
il manque l’audace de se croire et se défendre.
*
je ne suis pas encore assez seule.
mon crâne est une serre de bruits
foule forte
j’ai du mal à me rejoindre.
je flotte quelque part sous les plafonds de vitres
je suis d’une essence nuagière, et le nuage est une éponge.
ma voix dedans .
est-ce que ceci a de l’importance ? être un arbre devrait suffire.
la plaine aimerait y cogner son étendue, un échoasis.
sa solitude alors résonnerait,
la plaine où je sommeille, perdue
et l’on se dit que l’immense remercierait sans doute cette écorce où s’appuyer,
remercierait ces branches de soulever le ciel de verre.
on serait un instant ce point qui tient le regard comme la preuve d’une autre sève,
d’un autre domaine,
d’une matière ni bleue ni sable
seul un arbre des espèces de l’espérance.
*
Le matin, nous attendons une musique. On ne sait pas ce qui viendra. Des cloches ou des moteurs. On regarde le ciel pop- corn. On ne sait pas ou alors on aimerait ne pas savoir. On est à la gare. C’est parfois une seule arme blanche qui change la couleur de l’aurore. Je vois un cumulo-boeingus.
Je marche en cercle comme une bielle humaine. Peut-être suis-je à la manivelle du décor ? Maintenant le ciel bleuit- la lèvre aussi.
On voit que ça se bat, que c’est une violence de coton, forces noires. On imagine un pays de cobalt mais c’est la terre qui monte aux cieux.
*
Au bout de l’œil, il y a les arbres de la forêt. Sans doute je vois une cime qui est sous tes yeux. Laquelle ? Heureusement je l’ignore, comme je ne connais pas la configuration de tes nuages.
*
Maintenant la lueur derrière dilue les batailles, aquarelle sans nerf. Tentative de lissage du pot au noir. Elle dégouline un peu, les gens disent qu’il pleut. Je n’en sais rien mais de voir ces coulures, je pense à ce rimmel d’après la nuit.
Dimanche le jour, c’est la grisaille en pole position. Le soleil recule dans les tranchées de l’ailleurs. Je pédale régulière dans la plaine de la chambre. Ma voix lève la tête : un accroc, une plaie bleutée qui se recoud vite fait, efficace, dernière poche de noblesse dans l’espace.
Une sueur de poussières talquée dessus.
Je guéris de l’invisible autre part
*
Il y a des nuits qui vous en veulent. Vous y allez et la mort vous attend et vous pince à la cuisse, morsures ou becquées, l’oiseau vous entre dans la chair. Des picorements de charognards volent sur vous. Cette nuit avait un goût de fleuve sec. Je sentais sur moi l’odeur trafiquante qui voyage sur les corps quand l’esprit regarde ailleurs. Mon rêve, des histoires à mourir debout.
Ce matin être en vie est une surprise d’os, de muscles contractés , de gueule sèche. Je suis passée devant la vitre impossible., je ne voulais pas tenter le regard vorace qui me guette parfois quand j’ai honte d’avoir eu encore trop peur. Je voudrais m’allonger maintenant comme un fakir sur l’ombre de la forêt et que m’étrillent les cimes d’être une femme sans prière.
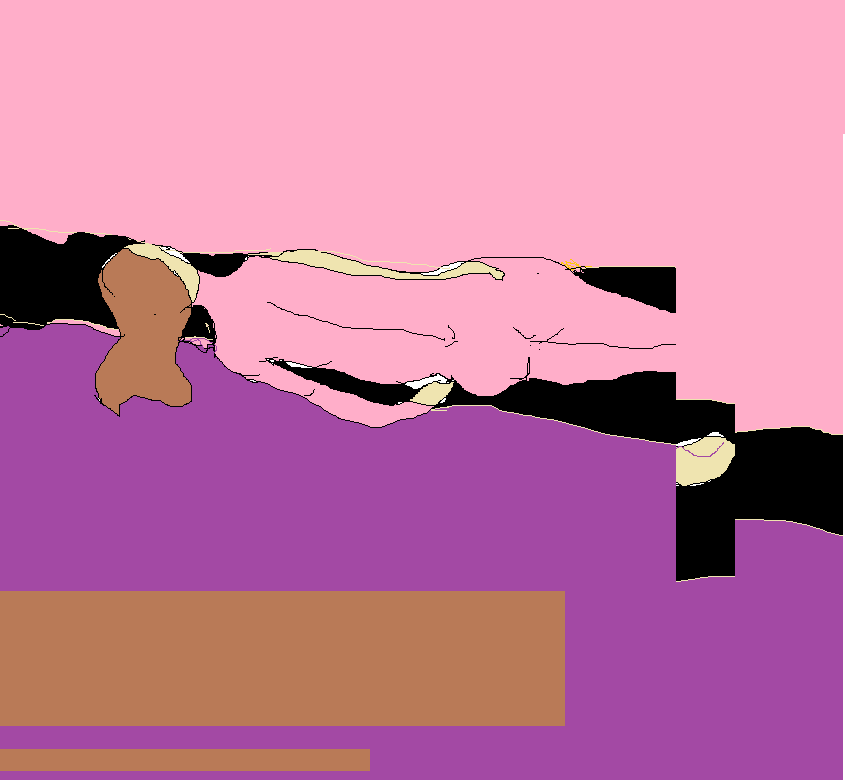
Messages
1. mai, 21 mai 2017, 19:33, par brigetoun
le beau cadeau